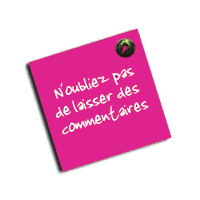Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois (1866)
RAPPORT SUR LA DÉCOUVERTE
D’UNE CONSTRUCTION GALLO-ROMAINE
au hameau de la Cunaille, commune de Thoré
(Loir-&-Cher),
Par M. A. L. de ROCHAMBEAU.A 300 mètres du Loir, à 200 pas du hameau de la Cunaille, dans un lieu appelé le Pied-de-Roi, considéré au moyen âge comme fief sous le nom de Bazineau, et qui limite au nord la plaine de Champrond, le terrain forme une pente assez raide du côté de la rivière. C’est dans ce terrain, exploité en sablonnière depuis plus d’un siècle et portant au cadastre le n° 243, que cette année, au commencement de janvier, des ouvriers mirent au jour un pan de mur qu’ils renversèrent. Avertis de cette découverte, nous nous rendîmes au lieu signalé, et, après quelques sondages préliminaires, nous ne tardâmes pas à nous rendre compte de la forme probable de la construction. La fouille complète, exécutée d’après ces premières données, fit voir un rectangle ayant 2m50 sur 3m45. Les murs élaient bâtis sans fondements de moellons. Sur le sable, qui offre du reste la plus grande solidité, est posée à plat une suite de pierres faisant socle, ayant 0m50 de large et 0m20 de hauteur. Sur ce socle de fortes pierres taillées ou plutôt dégrossies, dont plusieurs n’ont pas moins de 1m25 de long sur 0m25 d’épaisseur, sont placés sur champ, laissant au socle de chaque côté un relai de 0m15.
Le mur subsistant est formé d’un seul rang de pierres, et a, socle compris, 0,95 de haut. La partie supérieure est très-plane, et cet arasement semble prouver que le mur ne montait pas plus haut, et que la petite pièce que nous avons découverte se trouvait sous le plancher d’une salle de plus grande dimension. Au fond de ce réduit, du côté gauche, nous avons trouvé un escalier de trois marches soigneusement taillées. Chaque marche est formée d’une seule pierre. Cet escalier monte du sol de la pièce vers le niveau de la plaine, au midi, et la marche la plus haute est à 0m30 ou 0m40 au plus de la surface du sol arable. Elles ont chacune 0m20 de hauteur et 0m 40 de profondeur. De chaque côté, le sable arrive au niveau de l’arasement des murs ; l’intérieur seul était plein de terre végétale et rapportée. Cette raison, jointe à l’existence de l’escalier, prouve d’une manière évidente que cette construction a toujours été souterraine, et l’accotemenl des murs contre le sable explique leur peu d’épaisseur dans une œuvre romaine. En enlevant la terre végétale de l’intérieur, nous avons rencontré d’abord une quantité de briques rouges brisées. Quelques-unes sont cependant assez bien conservées pour qu’on puisse juger de leur forme et de leur dimension. Elles ont 0m40 de long, 0m30 de large et 0m02 d’épaisseur. De deux côtés, dans la longueur, elles ont un rebord de 0,05 de haut, entaillé au-dessus à l’un des bouts et au-dessous à l’autre, de manière à pouvoir s’enchâsser régulièrement. Elles sont légèrement convexes dans leur largeur, et portent à l’une des extrémités deux demi-cercles concentriques gravés en creux et correspondant à deux demi-cercles semblables reproduits sur la brique suivante. Elles pèsent chacune 4500 grammes. Nous avons aussi trouvé nombre de tuiles faitières (imbrices), de forme demi-cylindrique, rouges en dehors, blanchies à l’intérieur sans doute par le contact du mortier. Ces tuiles recouvraient la jonction de deux rangs de briques à rebord. Quelques briques droites, et ayant servi soit à un pavage grossier, soit à un appareil de maçonnerie, étaient aussi mêlées aux décombres, mais en petite quantité ; un des côtés semble par sa couleur avoir subi l’action du feu.
Arrivés au niveau des socles, nous avons commencé à trouver une terre noire où l’on reconnaissait parfaitement un mélange de cendres, des fragments de charbon de bois bien conservés et quelques pierres calcinées. Puis, au milieu de cette terre, une quantité de poteries cendrées, grisâtres, noires, rouges ou simplement rosées et de dimensions les plus variées ; quelques fragments de verre, des ossements d’animaux de boucherie, des écailles d’huîtres, des clous, etc.
Les vases de terre rouge vernissée occupent une large place dans cette trouvaille, et nous citerons d’abord un remarquable fragment de bol orné de jolis dessins en relief. Autour de la partie convexe, on voit une gracieuse guirlande de feuilles d’acanthe, et au-dessus, une autre série d’ornements. H avait environ 0,25 de diamètre et 0,08 à 0,10 de profondeur. Un autre tesson de vase d’une forme impossible à déterminer présente aussi beancoup d’intérêt. Sa pâte est plus fine encore que celle du bol ; sa surface paraît avoir été divisée eu compartiments. C’est une portion d’un de ces compartiments qui nous reste. Il est formé par une frise où s’alternent des ornements et des têtes fantastiques. Dans l’intérieur, on voit un guerrier dans l’attitude du combat ; il est coiffé du casque grec (galea), et son bras gauche porte un bouclier allongé chargé de diverses figures. Ce qui reste de ce joli bas-relief fait vivement regretter les parties manquantes. Nous avons retrouvé encore un grand nombre de fonds de vases et soucoupes dont le diamètre varie entre 3, 4, 6 ou 8 centimètres ; sur le bord d’une soucoupe serpentent des feuilles en relief avec les branches qui les soutiennent. Puis ce sont des fragments d’assiettes qui semblent avoir eu 0,12 de diamètre, de plateaux à rebords droits de 0,07 de hauteur, et dont le diamètre intérieur peut être évalué à 0,19 3, et quelques autres fragments, les uns ornés de divers dessins, les autres tout unis.
Un des fonds de vases porte dans l’intérieur le nom du potier Triupus |Trivpi-m|, marqué à l’estampille.
La terre qui fait ces poteries est appelée terra campana ou plus souvent terre samienne, de l’île de Samos qui en fournit en abondance. Mais c’est à tort que les premiers explorateurs lui ont donné cette appellation étrangère ; ce n’était qu’une composition faite en Gaule, el principalement dans les pays volcaniques, tels que l’Auvergne, l’Alsace et les provinces rhénanes.
En 1775, entre la ville de Lezoux et le château de Ligones ( Puy-de-Dôme ), le hazard fit découvrir des ateliers de poterie d’une grande étendue : soixante-dix à quatre-vingts fourneaux un peu plus grands que les fourneaux de chimie. Dans les dépendances d’une ferme dite La Poterie, près du Grand-Lucé ( Sarthe ), des cultivateurs trouvèrent, il y a une vingtaine d’années, une grande exploitation de potiers avec fourneaux, etc.
Aux environs de Lyon, on a rencontré aussi des fourneaux préparés spécialement pour la poterie samienne, et la Société des Antiquaires de France a signalé des fabriques semblables à Saverne et à Labrusche dans le Bas- Rhin. Amiens, Paris, la Normandie, le pays de Bray ont produit des potiers dont on retrouve, après quinze siècles, les charmants ouvrages. La terre qui les forme était donc bien tirée de la Gaule ; elle était fine, légère, moulée avec adresse et tournée avec goût ; toutes les décorations en sont dessinées avec art et intelligence. Presque tous les vases sont ornés à l’extérieur d’un beau vernis qui leur donne une teinte rouge de Venise, brun rouge ou oranger, et de filets gravés en creux. L’épaisseur des tessons varie de 0,002 à 0,01.
La poterie noire est aussi représentée par plusieurs échantillons, dont quelques-uns d’une grande finesse et vernis. Un fragment qui paraît avoir appartenu à une assiette ou un bol très-évasé porte un dessin uniforme et présentant une suite d’ondulations régulières, serrées et légèrement creuses. Un autre présente dans sa partie convexe des bandes horizontales un peu renflées et chargées de traits verticaux faits à la pointe. Nous signalons ces détails parce que généralement, dans les vases noirs, les dessins sont assez rares. Plusieurs fragments portent les traces d’un long usage et sont encore noircis par le contact du feu. Nous n’avons rencontré qu’un fond et quelques morceaux d’un vase blanc : il est soigneusement tourné, et la couleur, quoique superficielle, est très-adhérente. Puis ce sont de nombreux restes de vases en terres grises ou rosées, très-variées de finesse et d’épaisseur. Ces tessons paraissent presque tous avoir appartenu à des récipients de grande dimension. Nous avons remarqué entre autres un fragment de terrine en grès gris fort épais et passée au tour. Ses bords évasés forment un boudin de 4 à 5 centimètres d’épaisseur ; elle est munie d’un large bec ou déversoir pour faciliter l’écoulement du liquide. On y voyait aussi le rebord, les anses et le fond pointu d’une amphore ; enfin, le fond d’un dolium en terre très-grossière et très-poreuse. Le dolium servait à contenir l’Ruile ou le vin. Son usage a duré dans la Gaule jusque vers l’an 260 après J. G. En somme, nous avons mis au jour les restes de toute une vaisselle gallo-romaine ; le service de table, vases, assiettes, bols, soucoupes en terre rouge et noire et en verre ; les pièces communes, vases en terre grise, amphores, terrines, dolium, etc. Rien n’y manque. Nous citerons encore, parmi les objets exhibés, deux fragments striés d’urne en verre mince, et un morceau petit mais épais de verre plat qui doit être un débris de vitre. L’existence des carreaux de vitre a déjà été constatée dans les ruines d’habitations romaines ; cependant ils sont rares, et si minime que soit le fragment, il mérite d’être remarqué.
A cet inventaire nous joindrons une douzaine de clous fortement oxydés, dont plusieurs à tête plate et à tige carrée, mesurant 11 centimètres de longueur ; l’axe osseux des deux cornes d’un jeune bœuf ou vache. Elles ont été sciées pour débarrasser la tête de ses cornes, comme on le fait encore maintenant ; plusieurs dents qui paraissent avoir appartenu à la même tête ; une portion de mandibule inférieure gauche et le métacarpien d’un mouton adulte ; celui d’un chevreau et plusieurs autres débris d’animaux de boucherie.
Maintenant que nous avons énuméré les divers objets trouvés à la Cunaille, il nous reste à chercher la destination primitive de notre petit édifice. Nous remarquerons d’abord qu’à 50 mètres au nord, du côté de In rivière, on voit encore une fosse creusée de main d’homme. qui a 80 mètres de long sur 5 mètres de large. Cette fosse a toujours renl’enné du poisson, et les plus anciens habitants du voisinage ne l’ont jamais vue tarir. Evidemment elle n’a pas de tout temps été isolée au milieu des terres ; elle dépendait de l’habitation dont nous avons retrouvé sans doute une bien petite partie. Par qui était occupée cette habitation ? La réponse n’est pas douteuse, les poteries que nous avons décrites nous la donnent : elle l’a été par les Romains, vers le IIIe ou le IVe siècle de notre ère. A quel usage était-elle consacrée ? Ici la solution est plus difficile. Comme nous le disions tout à l’heure, il est plus que probable que la construction que nous avons rencontrée n’était qu’une faible portion de l’édifice primitif. Son insolite exiguïté nous en par ; ît une preuve. Nous avons démontré, au commencement de ce mémoire, qu’il avait toujours été souterrain ; l’arasement des murs, le tassement du sable en dehors et au même niveau semblerait démontrer l’existence de solives posées en travers et formant le plancher d’une salle construite à la hauteur de la dernière marche de l’escalier.
Alors, le réduit découvert n’aurait eu que 0,95 d’élévation, hauteur insuffisante pour qu’un homme puisse s’y tenir debout. Qu’avons-nous rencontré d’abord ? De la terre végétale. Au milieu de cette terre, du mortier et quelques moellons destinés à corriger les inégalités des pierres de taille formant les murs ; puis une quantité de briques à rebord et faitières ; tout cela est tombé d’en haut, la disposition est bien celle d’un éboulement. Arrivés au niveau du sol, seulement, les poteries, clous, etc. De ce que nous n’avons rencontré dans les décombres aucun fragment de poteries ou autres, nous concluons que ces objets étaient déjà en place au moment de l’éboulement. On jetait donc là les objets cassés et hors d’usage, les os et débris de cuisine. C’était peut- être une sorte d’égout ou de sous-sol (cella) dépendant de la cuisine.
De tout ce qui précède, nous supposons, au IIIe siècle, une villa romaine, abritée des vents du sud-ouest par les arbres séculaires de l’antique forêt de Champ- rond. A 300 mètres du Loir, elle en a les avantages, sans en avoir à craindre les inondations. César nous dit que généralement on établissait les habitations de préférence dans le voisinage des forêts et des rivières, dans le but d’éviter les chaleurs de l’été. Telle était notre villa ; elle se trouvait sans doute aussi près d’un chemin se reliant à une grande route antique. 11 est vrai qu’on n’a encore trouvé aucune trace de voie romaine dans la commune de Thoré ; mais il est un fait certain, c’est qu’au Gué-du-Loir, qui fait face au hameau de la Cunaille, convergeaient toutes les voies antiques situées de l’autre côté de la rivière. Ces voies avaient évidemment des issues sur la rive qui nous occupe. Nos présomptions nous amèneraient, sinon à reconnaître, du moins à supposer, deux voies romaines partant du Gué-du-Loir, sur le territoire de Thoré. L’une aurait suivi la rivière et se serait dirigée vers la partie du bourg appelée les Châteaux ; l’autre, longeant notre villa, aurait été remplacée et modifiée, au moyen âge, par le vieux chemin, connu aujourd’hui sous le nom de Chemin de Blois. Elle aurait monté en droite ligne le coteau de Rochambeau, gravi les hauteurs de Varennes, s’écartant un peu à gauche de la Higaudière pour se rapprocher de Villerable, passé près des villages de Puteaux, Le Plessis de Crucheray, Pinoche, Villeromain, etc., etc.
La famille qui habite notre villa a pour chef quelque centurion que le général a récompensé de ses longs services en l’enrichissant des dépouilles des vaincus [1]
Nouveau jalon de la civilisation romaine, il défriche, anime ces campagnes, dont la sombre majesté le tient encore en respect. Aussi n’a-t-il pas oublié les ordres de son chef : à deux kilomètres de là, au lieu qu’on appelle aujourd’hui les Châteaux, est un autre poste d’observation. Plusieurs fois le jour, il monte sur la terrasse de son habitation pour voir si son compagnon de combats ne lui signale pas un danger. Rassuré par son silence, il revient à ses paisibles travaux. Un jour, des nuées d’hommes barbares envahissent la Gaule ; rien ne leur résiste. Comme tant d’autres, notre villa est saccagée et ses colons réduits en esclavage. Le petit caveau passe inaperçu, et ses poutres restent cachées sous les ruines. Cependant les solives finissent par se consommer ; alors le plancher s’effondre, entraînant les briques et les terres qui les couvrent.
Le moyen âge arrive ; le serf cultive la glèbe à laquelle il est attaché ; il veut niveler le sol et le débarrasser des décombres qu’il éparpille au gré du hasard, remplit avec de bonnes terres le vide qu’il aperçoit, et tout disparaît aux yeux indifférents des secrets de l’antiquité.
[1] Alexandre-Sévère décréta que tout officier ou soldat vétéran recevrait en même temps que son congé une portion de terre avec les esclaves, les bestiaux, les instruments aratoires nécessaires pour la mettre en valeur. Ces bénéfices militaires étaient surtout établis le long des fleuves et des rivières, et Alexandre espérait ainsi placer dans les provinces autant de vedettes formant un système de défense contrules invasions des barbares. (Lampridius, Alexandre-Sévère, C. 53.)